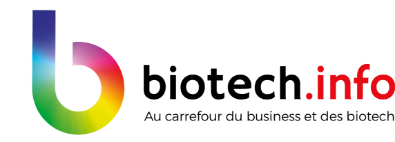Non classé
Santé humaine
Édito
Le cerveau : un continent immense dont on découvre peu à peu les mystères
Edito du Sénateur René Trégouët en partenariat avec
RTFlash 11 janvier 2019

Au cours de ces derniers mois, plusieurs études particulièrement intéressantes sont venues éclairer notre connaissance, encore très parcellaire, des innombrables mécanismes et processus par lesquels notre cerveau parvient à décrypter et à reconstruire son environnement et à fonctionner avec une telle efficacité en nous permettant d’accomplir les actions les plus appropriées aux situations les plus diverses.
Pour parvenir à construire en permanence une représentation cohérente et heuristique du réel, notre cerveau fait appel à de nombreux mécanismes de sélection, de hiérarchisation et d’orientation qui lui permettent d’ordonner l’univers infini de ses idées dans l’espace et dans le temps. Aujourd’hui, grâce aux extraordinaires progrès dans le domaine des neurosciences, ces mécanismes, dont l’existence a été pressentie depuis très longtemps par les grands penseurs, commencent enfin à être mieux compris, même si leur exploration ne fait que commencer.
En 2005, Edvard Moser et May-Britt Moser avaient découvert un nouveau type de cellules cérébrales qui permettent aux animaux et aux êtres humains d’être conscients de leur position dans l’espace, ce qui leur vaudra le prix Nobel de médecine en 2014. Avec ses collègues Trygve Solstad, Charlotte N. Boccara et Emilio Kropff, Edvard Moser a publié, en août dernier, un article très important dans la revue “Science” intitulé « Représentation des limites spatiales dans le cortex enthortinal » (Voir Science).
Dans ces travaux réalisés sur des rats, ces chercheurs ont pu montrer que, lorsque nous nous déplaçons, soit à l’extérieur, soit dans un espace fermé, deux types de cellules sont mobilisées pour nous aider à nous repérer et nous orienter : d’une part, les cellules de lieu, une catégorie de neurones qui s’activent lorsque nous arrivons dans un lieu précis et, d’autre part, les cellules de grille, découvertes par Edvard et May-Britt Moser, qui vont permettre à notre cerveau de se faire une représentation de l’espace dans lequel nous évoluons. C’est le travail coordonné de ces deux types de cellules qui nous dote d’un véritable système d’orientation et de navigation, nous permettant de savoir où nous sommes et où nous allons.
Mais cette étude a également montré que ces types de neurones ne se contentent pas de permettre la réalisation en temps réel d’une cartographie dynamique de notre environnement ; ils établissent également une multitude de relations entre les objets et les épisodes de notre vie. Par ce processus, le cerveau construit et gère des espaces cognitifs, véritables cartes mentales dans lesquelles nous rangeons nos différentes expériences. Celles-ci ont des propriétés physiques qui permettent de les ordonner dans différentes dimensions. “Par exemple, si je pense à des trains, je peux les classer en fonction de leur forme, de leur mode de propulsion (vapeur, diesel, électrique…) ou encore de leur longueur, ce qui va me permettre de combiner à l’infini ces différentes représentations du concept de train“, explique le professeur Doeller.
Pour ce chercheur, le processus serait le même quand nous pensons à des personnes particulières et, en fonction des différences caractéristiques de ces individus (leur physique, leur âge, leur caractère, leur situation sociale), ceux-ci auront une place donnée dans cette cartographie mentale. Au cours d’une expérience très intéressante réalisée dans le cadre de cette étude, les participants devaient associer des images d’oiseaux, dont la longueur du cou et des pattes était modifiée, avec des symboles différents, comme un arbre et une cloche. A chaque combinaison correspondait un symbole particulier. Les participants ont ensuite été soumis à un test de mémoire réalisé pendant un scanner cérébral, et ont dû indiquer pour chaque oiseau à quel symbole il était associé. Ce test a permis de constater que l’exercice activait bien les mêmes zones du cerveau que lorsque nous avions besoin de notre “système de navigation”, ce qui montre que nous utilisons un système de coordonnées pour classer nos expériences, mais également, et plus largement, pour structurer nos pensées et les concepts que nous produisons.
Comme le souligne Jacob Bellmund, “Ces processus sont particulièrement utiles pour effectuer des déductions à propos de nouveaux objets ou de nouvelles situations, même si nous ne les avons jamais rencontrés, car, en utilisant les cartes existantes d’espaces cognitifs, nous pouvons anticiper les similitudes entre un objet ou une situation nouvelle, et quelque chose que je connais déjà en le mettant en relation avec les dimensions existantes“. Cette nouvelle théorie de la pensée pourrait avoir des applications dans de nombreux domaines scientifiques et médicaux ou cognitifs, qu’il s’agisse des maladies neurodégénératives, de l’intelligence artificielle, ou encore de méthodes d’apprentissage.
Mais si le cerveau doit sans cesse s’orienter dans l’espace, il doit également être capable de se repérer dans le temps pour pouvoir comprendre son environnement, produire des idées et agir de manière efficace sur le réel qui l’entoure. Jusqu’à présent, le rôle fonctionnel de cette structure restait un mystère. Mais récemment, une remarquable étude publié en août dernier dans Nature (Voir Nature) sous la direction d’Albert Tsao (Institut Kavli des neurosciences à Trondheim, en Norvège) et intitulée « Comment le cortex entorhinal intègre l‘expérience temporelle » a permis de franchir une nouvelle étape dans la compréhension des mécanismes par lesquels notre cerveau perçoit de manière variable l’écoulement du temps.
Cette étude, à laquelle ont également participé May-Britt et Edvard Moser, a identifié le circuit cérébral qui nous permet d’associer une temporalité aux événements et de les ordonner chronologiquement. Ce mécanisme fait intervenir le cortex entorhinal latéral (lateral entorhinal cortex, LEC), une structure cérébrale profonde qui permet notamment le transfert d’informations vers l’hippocampe, siège de la formation des souvenirs.
En utilisant des outils d’intelligence artificielle, ces chercheurs ont pu montrer que le taux de décharge des neurones dans cette région fluctue avec le temps qui passe. « Nos travaux montrent de manière convaincante que le temps n’est pas encodé de manière explicite par ces neurones, comme une horloge qui décompterait les secondes, mais plutôt de manière diffuse, à travers le flot d’événements que l’on vit en permanence et qui change perpétuellement », précise Albert Tsao, le chercheur qui a dirigé cette étude. Il semblerait donc que le cortex latéral enthortinal – CLE – encode les informations relatives aux événements vécus et à leur ordre chronologique, en donnant une information implicite sur le temps écoulé.
Notre perception du temps écoulé dépendrait par conséquent des événements que nous vivons, comme le montre une autre expérience, consistant à enregistrer l’activité neuronale de rats contraints de répéter la même trajectoire à l’intérieur d’un labyrinthe. Dans ce test, les scientifiques ont pu constater une réduction sensible du flux d’informations temporelles encodées, une observation parfaitement logique selon Albert Tsao qui souligne que « Dans une tâche répétitive comme celle-ci, la nature des événements vécus est très similaire d’un essai à l’autre par rapport à une situation d’exploration libre. Le temps épisodique écoulé est donc raccourci ».
Autre avancée scientifique très intéressante, celle réalisée il y a quelques semaines par des chercheurs de l’Inserm au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Ces derniers se sont intéressés aux mécanismes permettant au cerveau de ressentir le toucher à travers les outils (Voir Inserm). À cette fin, ils ont réalisé plusieurs expériences de localisation d’un coup porté sur un bâton tenu en main. Dans l’une de ses expériences, un chercheur frappait à différents endroits sur le bâton tenu en main par un volontaire dont la vision était obstruée. Les chercheurs lui ont ensuite demandé de localiser l’impact (au bout du bâton ou plus haut, près de la main par exemple).
Les scientifiques ont pu alors constater que la précision de cette localisation était aussi grande lorsque le choc était administré sur le bâton, quel que soit l’endroit, que lorsqu’il était administré sur le bras du volontaire… Ces résultats démontrent la capacité humaine à incorporer l’ensemble d’un outil tenu en main comme s’il faisait partie de son propre corps, le cerveau l’intégrant comme un organe des sens à part entière, souligne cette étude qui évoque un mécanisme de “perception étendue par les outils”. C’est ce mécanisme que connaissent intuitivement et utilisent remarquablement les grands musiciens, dont les instruments deviennent de véritables prolongements du corps.
Dans cette actualité neuroscientifique particulièrement riche, il faut également noter la surprenante découverte réalisée il y a peu par des chercheurs du Centre des Neurosciences d’Australie, dirigés par Georges Paxinos. Ces chercheurs ont en effet découvert, en combinant de nouvelles techniques d’imagerie et de coloration cellulaire, une nouvelle zone du cerveau dont la fonction reste inconnue pour l’instant.
Baptisée “noyau endoréstiforme”, cette petite région du cerveau se situe près de la jonction du cerveau et de la moelle épinière, dans le pédoncule cérébelleux inférieur, un espace qui combine les informations sensorielles et motrices, et nous permet d’effectuer des mouvements fins et complexes. “Cette région est intrigante parce qu’elle n’existe pas chez le singe rhésus et d’autres animaux que nous avons étudiés ; elle ne semble être présente que chez l’homme”, explique George Paxinos, anatomiste australien et directeur de la recherche (NeuRA). Au-delà de son intérêt sur le plan fondamental, cette découverte pourrait avoir à terme des conséquences thérapeutiques dans le traitement des pathologies neurodégénératives qui affectent la mobilité et la dextérité, comme la maladie de Parkinson.
Une autre équipe de recherches américaine du Stanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute de San Diego (Californie), a également réalisé il y a quelques semaines une découverte majeure qui a fait sensation dans la communauté scientifique. Ces chercheurs ont en effet montré que des recombinaisons génétiques pouvaient avoir lieu dans des neurones. L’étude s’est intéressée au gène APP qui code pour le précurseur de l’amyloïde, la protéine qui a tendance à s’accumuler dans les cerveaux des patients atteints d’Alzheimer (Voir Science).
Ces recherches ont montré que tous les échantillons de cerveaux Alzheimer étudiés contenaient un nombre de variants du gène APP bien plus important que ce que l’on pouvait trouver dans des cerveaux normaux. Et surtout, parmi ces variants, ont été observées onze mutations déjà répertoriées pour favoriser des formes familiales de la maladie d’Alzheimer. Ces scientifiques soulignent que cette modification du génome des cellules a obligatoirement nécessité deux étapes-clé : une rétrotranscription (la synthèse d’un ADN à partir d’un ARN) et la réinsertion du variant génétique dans le génome. Or, la rétrotranscription nécessite une enzyme, la transcriptase inverse, un type d’enzyme trouvé chez les rétrovirus comme le VIH. Selon ces travaux, des médicaments antirétroviraux pourraient donc être efficaces contre la maladie d’Alzheimer !
On savait déjà que ce processus de recombinaison génétique pouvait avoir lieu dans les cellules germinales ou immunitaires comme les lymphocytes B. Mais c’est la première fois qu’elle est formellement identifiée dans le cerveau. « Ces résultats pourraient modifier fondamentalement non seulement notre compréhension du cerveau, mais aussi celle de la maladie d’Alzheimer », explique Jerold Chun, principal auteur de cette étude. « Si nous considérons que l’ADN est un langage que chaque cellule utilise pour « parler », nous sommes obligés d’admettre à présent que, dans les neurones, un seul mot peut générer plusieurs milliers de nouveaux mots, non reconnus auparavant… ».
Enfin, terminons ce passionnant tour d’horizon en évoquant une étude très intéressante qui montre que la connaissance de notre cerveau et de son évolution tout au long de la longue histoire de notre espèce n’est envisageable qu’en prenant en compte le vaste ensemble d’interactions et de rétroaction qui existe entre cerveau, société, culture et environnement. Dans ce travail, des chercheurs Canadiens et Américains proposent une hypothèse visant à expliquer pourquoi la taille du cerveau humain a triplé depuis l’apparition des premiers hominidés en Afrique il y a environ 7 millions d’années (Voir PLOS).
Selon eux, cet accroissement considérable du volume cérébral résulterait principalement de la nécessité de rendre plus rapide et plus efficace le processus d’apprentissage, afin que nous soyons capables de réagir avec pertinence à des environnements changeants et hostiles. Cette théorie du cerveau culturel repose sur l’idée que ce développement du cerveau a permis de stocker et de gérer la quantité croissante d’informations générées par la complexité de plus en plus grande des sociétés et des cultures humaines au fil du temps. Selon cette hypothèse, ces informations accumulées par les êtres humains sur des milliers de générations ont pu « conduire à une meilleure sélection des cerveaux lors de l’apprentissage social ». L’augmentation considérable de la taille de notre cerveau résulterait donc d’un mécanisme évolutif global, favorisant la survie des individus et la pérennité de l’espèce et s’inscrivant dans un cadre darwinien élargi.
On le voit, l’exploration et la connaissance de cet immense continent qu’est le cerveau ne peuvent plus se réduire à sa seule dimension biologique et s’inscrivent à présent dans une démarche résolument transdisciplinaire, associant les sciences du vivant mais également les neurosciences, l’intelligence artificielle et l’ensemble des sciences sociales.
Nous devons tout mettre en œuvre pour que ces remarquables avancées scientifiques se poursuivent au même rythme, non seulement pour satisfaire notre légitime soif de connaissance mais également pour avancer, d’ici le milieu de ce siècle, vers de véritables révolutions thérapeutiques dans le traitement des maladies psychiatriques et neurologiques qui deviennent, avec le vieillissement inexorable de notre population, un immense défi médical et social.
René TRÉGOUËT
Sénateur honoraire
Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat