Santé humaine
Édito
Lutte contre le cancer : des progrès extraordinaires réalisés grâce à l'immunothérapie
En partenariat avec RTFlash Vendredi, 05/01/2018,
Edito du Sénateur René Trégouët
 Même si la vaccination a été pratiquée de manière empirique en Chine dès le XVIème siècle, c’est en 1776 que l’anglais Jenner mit en œuvre pour la première fois, à grande échelle sur l’homme, de manière scientifique, le principe de la vaccination : l’immunologie était née.
Même si la vaccination a été pratiquée de manière empirique en Chine dès le XVIème siècle, c’est en 1776 que l’anglais Jenner mit en œuvre pour la première fois, à grande échelle sur l’homme, de manière scientifique, le principe de la vaccination : l’immunologie était née.
Parallèlement aux travaux de Pasteur en France, en 1887, Paul Ehrlich, immense scientifique allemand développa une remarquable et visionnaire théorie de l’immunité, basée sur l’interaction entre les antigènes et les anticorps. Il obtiendra pour ses travaux le Prix Nobel de Médecine en 1908.
Les anticorps, on le sait, sont des protéines sécrétées par certaines cellules du système immunitaire qui s’attachent aux substances étrangères à l’organisme (bactéries, virus), appelées antigènes. Ainsi repérés et marqués, ces agents pathogènes peuvent alors être attaqués et détruits par certaines types de cellules du système immunitaire. Ce dernier se souvient ensuite de ces antigènes et peut, s’il est confronté à nouveau à des agents pathogènes qu’il connaît ou à des cellules anormales, déclencher une riposte appropriée en libérant les mêmes anticorps.
Il fallut attendre 1961 pour connaître la structure fine des anticorps (Edelman et Porter, Prix Nobel de médecine 1972) et 1975, avec les travaux de Georges Köhler et César Milstein, pour que l’on sache fabriquer les anticorps monoclonaux qui sont des anticorps artificiellement produits à partir de clones de cellules contre un antigène spécifique. Le premier anticorps monoclonal a été commercialisé en 1986. Mais c’est le début du 21ème siècle qui marque vraiment l’émergence des anticorps monoclonaux en tant qu’outil thérapeutique ciblé.
Il existe à présent environ une cinquantaine d’anticorps monoclonaux disponibles ou en phase finale d’expérimentation et plus de 400 sont en développement (dont la moitié est destinée à lutter contre les cancers) et ces extraordinaires outils immunologiques ne cessent d’élargir leurs champs thérapeutiques ; ils sont aujourd’hui expérimentés ou utilisés contre de multiples pathologies, cancers, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis, leucémie myéloïde, asthme, DMLA…
C’est toutefois dans le domaine de la cancérologie que ces anticorps monoclonaux et les immunothérapies qui en découlent ont amorcé depuis une dizaine d’années une véritable révolution, porteuse d’immenses espoirs.
L’année dernière, une étude internationale présentée au congrès mondial de cancérologie clinique de l’ASCO à Chicago a montré l’efficacité d’un de ces anticorps monoclonaux, l’atezolizumab, contre les tumeurs de la vessie. « C’est un progrès majeur face à une maladie pour laquelle la principale chimiothérapie, le cisplatine, a été développée il y a plus de 40 ans », explique le Docteur Olivier Mir, cancérologue à l’Institut Gustave Roussy. L’atezolizumab, développé par Roche, est une immunothérapie conçue pour bloquer des sites moléculaires appelés PD-L1, qui permettent aux cellules cancéreuses de leurrer les lymphocytes T, les types de globules blancs chargés de détruire les cellules pouvant provoquer des maladies.
Compte tenu de son efficacité, l’atezolizumab a reçu une autorisation de mise sur le marché accélérée aux États-Unis par la FDA, l’autorité réglementaire américaine, avec une indication contre le cancer de la vessie. Les essais cliniques menés dans plusieurs pays sur des patients à un stade avancé de la maladie ont confirmé la nette supériorité thérapeutique de cet anticorps, par rapport au traitement classique par cisplatine. Cette nouvelle molécule permet en effet de tripler ainsi la durée de vie moyenne de ces malades, ce qui constitue une avancée sans précédent dans le traitement de ce type de cancer grave.
Le premier cancer dont le traitement a été bouleversé par cette approche est le mélanome métastatique. Depuis 2011, la prise en charge de ce type de cancer par le nivolumab et l’ipilimumab (qui agissent sur le récepteur CTLA-4), puis par le pembrolizumab (qui agit sur le récepteur PD-1) a été révolutionnée par l’arrivée de l’immunothérapie et, plus spécifiquement, l’immunomodulation anti-tumorale.
Pour parvenir à rendre à nouveau sensibles et détectables les cellules cancéreuses, et à éviter qu’elles échappent à la vigilance du système immunitaire en inhibant l’activation des lymphocytes T, les chercheurs ne cessent de développer de nouveaux anticorps monoclonaux qui réussissent avec de plus en plus d’efficacité et de précision à cibler ces voies d’activation de l’immunité, ce qui provoque une réaction rapide et vigoureuse du système immunitaire contre les cellules cancéreuses. Deux catégories de médicaments ont montré un bénéfice par rapport à la seule chimiothérapie : les anti-CTLA-4 et les anti-PD-L1. Aujourd’hui, grâce à la combinaison de ces thérapies immunitaires, plus du tiers des malades atteints de mélanomes métastatiques sont encore en vie plus de 5 ans après l’apparition de leur maladie, ce qui est un changement radical en termes de pronostic pour ce cancer grave.
En juin dernier, lors du congrès mondial sur le cancer à Chicago aux Etats-Unis, une équipe française de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne) a montré que le traitement par immunothérapie reposant sur l’utilisation du nivomulab pouvait soigner les cancers dits “féminins”, comme celui du col de l’utérus. Chez 70 % des patientes, le traitement a permis de stabiliser la maladie. Pour 20 % des femmes traitées, le cancer a même régressé. Après avoir marqué des points décisifs contre le mélanome, le cancer du rein et le cancer du poumon, les scientifiques tentent également, grâce à l’immunothérapie, de mieux combattre certains cancers du sein réfractaires à tous traitements.
Dans ces types de cancers, des réponses cliniques durables ont été observées chez des patients à des stades avancés, qui répondent mal à la chimiothérapie et qui ont développé des métastases. Les scientifiques tentent également d’utiliser ces immunothérapies pour s’attaquer à un type de cancer du sein agressif, appelé « triple négatif », qui ne répond pas aux traitements classiques et représente 15 % des cancers du sein qui touchent des femmes plus jeunes. Le but des chercheurs est de parvenir, par une utilisation judicieuse de ces nouveaux anticorps monoclonaux, à « déverrouiller » les défenses immunitaires, appelées “check-points”. Si ces anticorps peuvent être si efficaces, c’est qu’ils possèdent la propriété non pas de cibler les cellules malignes, comme c’était le cas avant, mais d’agir directement sur le système immunitaire lui-même, en le reprogrammant de manière à ce qu’il mobilise toutes ses capacités pour s’attaquer spécifiquement au type de cancer dont souffre le patient.
Reste que, parfois, notre système immunitaire ne parvient plus, pour des raisons multiples qui sont de mieux en mieux connues, à détecter et à éliminer ces cellules malignes qui peuvent alors se disséminer dans l’organisme. Mais des recherches récentes permettent de mieux comprendre ce phénomène (Voir article Nature). En 2009, le Docteur Irving Weissman, directeur de l’Institut de Stanford pour les cellules souches et la médecine régénératrice, a montré que les cellules cancéreuses les plus agressives ont un haut niveau de CD47, une protéine à la surface de la membrane. Celle-ci s’attache à la protéine SIR alpha, qui se retrouve sur la surface des macrophages.
Ainsi, les macrophages, qui constituent la première ligne de défense de l’organisme, ne peuvent plus s’attaquer aux cellules anormales du cancer. L’équipe du Docteur Weissman a pu montrer sur la souris qu’un traitement anti-CD47 bloque cette protéine de surface de la cellule cancéreuse, rend ces cellules à nouveau repérables par le système immunitaire et augmente significativement la capacité des macrophages à détruire les cellules cancéreuses.
L’équipe du Docteur Weissman a découvert récemment d’autres protéines de blocage du système immunitaire inné vis-à-vis des cellules cancéreuses. Ces chercheurs ont notamment montré qu’un haut niveau de la protéine MHC de type 1 rend les cellules cancéreuses plus résistantes aux traitements anti-CD47. Cette équipe a également montré qu’une autre protéine, présente elle sur les macrophages, LILRB1, s’attache à la MHC de type 1, ce qui empêche ces macrophages de détruire les cellules cancéreuses. Les premiers essais sur des souris ont montré qu’en agissant conjointement sur les protéines CD47 et LILRB1, la croissance des tumeurs était significativement réduite.
Autre avancée importante, en Grande Bretagne, des chercheurs de l’Université de Cardiff ont récemment trouvé un moyen de stimuler la capacité de destruction des cellules T du système immunitaire, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques contre de nombreux cancers. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont utilisé l’outil d’édition du génome désormais incontournable CRISPR, ce qui leur a permis de modifier des lymphocytes T tueurs en supprimant leurs récepteurs non cancéreux et en les remplaçant par des récepteurs capables de reconnaître des cellules cancéreuses spécifiques et de les détruire.
Le Docteur Mateusz Legut, qui dirige ces recherches, donne une explication à cette découverte, « Jusqu’à présent, les cellules T conçues pour combattre le cancer présentaient deux types de récepteurs : Comme il n’y a qu’un espace limité sur une cellule pour les récepteurs, ceux qui sont spécifiques au cancer doivent rivaliser avec les propres récepteurs de la cellule pour remplir leur fonction. Ce mécanisme ne permet malheureusement pas une mobilisation totale des cellules T contre certains cancers ».
Mais en utilisant judicieusement l’édition du génome CRISPR, ces scientifiques ont permis aux lymphocytes T de n’utiliser que le seul récepteur spécifique au cancer à combattre, faisant de ces cellules tueuses des armes bien plus agressives contre les cellules cancéreuses. Ces chercheurs se disent persuadés que l’utilisation des nouveaux outils d’édition génétique va révolutionner l’immunothérapie du cancer, en permettant la mise au point de nouveaux traitements personnalisés, à la fois bien plus sélectifs et plus efficaces.
Aux Etats-Unis, l’équipe du Professeur Michael Diamond, de l’Université Washington à St. Louis, a montré que le virus du Zika pouvait détruire chez la souris les cellules du glioblastome qui sont résistantes aux thérapies actuelles et rendent ce cancer du cerveau très agressif. Avantage supplémentaire de cette approche immunothérapique, ce virus ne s’attaque qu’aux cellules malignes.
Une autre équipe de l’Institut Duke de cancérologie (Caroline du Nord) a réussi à modifier le virus de la polio pour pouvoir l’utiliser comme arme de destruction sélective de certaines tumeurs du cerveau et les résultats sont jugés très encourageants : pour ce cancer qui entraîne normalement le décès des malades en moins d’un an, 20 % des patients traités par ce virus modifié sont toujours en vie, dont certains plus de cinq ans après le début de leur immunothérapie…
En France, le programme Pioneer lancé il y a quelques jours à Marseille pour cinq ans, associe chercheurs, cliniciens et le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Il vise à mieux comprendre pourquoi ces nouveaux traitements immunothérapiques, comme Opdivo de BMS ou le Keytruda de Merck, ne fonctionnent pas chez tous les patients. Un essai clinique portera sur 450 patients ayant rechuté après chimiothérapie et candidats à un traitement d’immunothérapie. « Le but sera de déterminer si l’ajout d’une deuxième molécule d’immunothérapie, agissant sur un autre mécanisme du système immunitaire, restaure l’efficacité de ce dernier et permet aux patients de reprendre le contrôle de leur maladie », précise le Professeur Fabrice Barlesi. Ce projet vise également à identifier de nouveaux marqueurs biologiques pour prédire quel traitement est le plus adapté à chaque patient.
Une autre équipe française, celle de Marc Grégoire (Inserm de Nantes), est également à la pointe mondiale dans ces recherches de nouvelles immunothérapies anticancéreuses et travaille à combattre le mésothéliome (un cancer de la plèvre principalement dû à l’amiante), en utilisant de façon judicieuse différents vaccins, dont le vaccin contre la rougeole. Ces travaux ont montré que le vaccin de la rougeole attaquait directement les cellules cancéreuses, sans toucher aux cellules saines, et rendait au système immunitaire des malades ses capacités à reconnaître et à détruire ces cellules malignes. Les premiers tests réalisés sur 250 patients se sont avérés très encourageants et n’ont entraîné aucun effet secondaire sévère. Comme le souligne Marc Grégoire, « En associant ces vaccins contre les virus à l’immunothérapie, on devrait arriver à des résultats extraordinaires contre certains cancers aujourd’hui très difficiles à traiter ». Pour le moment, les chercheurs utilisent une dizaine de vaccins, dont ceux contre l’herpès, la polio, la rougeole ou contre la variole. Parmi les cancers qui font actuellement l’objet de ces traitements expérimentaux avec ces virus oncolytiques, on trouve le mélanome, le cancer du poumon, les cancers du cerveau ou de l’ovaire.
Evoquons enfin le rôle clé que semble jouer le microbiote intestinal dans la réponse à l’immunothérapie dans le traitement du cancer. Selon de récents travaux menés par une équipe internationale associant des chercheurs français (Gustave Roussy, l’Université Paris-Sud et Université Paris-Saclay) avec leurs collègues du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, du Weill Cornell Medical College (US) et du Karolinska Institute (Suède), certaines bactéries intestinales peuvent en effet stimuler les traitements immunothérapiques contre le cancer (Voir Science).
Ces recherches ont testé l’efficacité de deux types d’immunothérapie chez la souris modèle de sarcome ou de mélanome, certaines souris ayant reçu des antibiotiques. Les chercheurs ont ensuite observé si les souris traitées avec des antibiotiques présentaient une meilleure réponse à l’immunothérapie si elles recevaient une greffe de selles de certains participants de l’étude répondant bien à l’immunothérapie.
Résultats : chez les souris modèles de mélanome ou de sarcome ayant reçu des antibiotiques, les traitements sont moins efficaces et la survie diminuée. Ces chercheurs ont également examiné 249 patients présentant une forme avancée du cancer du poumon non à petites cellules, de cancer du rein ou de cancer de la vessie ou des uretères, en prenant en compte la prise d’antibiotiques chez certains patients, soit 2 mois avant soit 1 mois après le début de l’immunothérapie. Le microbiote intestinal de 100 de ces patients a également été analysé par séquençage de l’ADN.
Ces analyses montrent que la composition bactérienne de la flore intestinale des patients qui répondent bien à l’immunothérapie semble être assez spécifique et diffère sensiblement de celle des patients qui répondent mal à ces thérapies ; en outre, chez les patients ayant reçu des antibiotiques, l’immunothérapie s’avère moins efficace à la fois et le temps moyen de survie globale se trouve diminué. Ces recherches montrent enfin que, chez les participants ayant une meilleure réponse au traitement, on observe une présence plus importante de la bactérie Akkermansia muciniphila. A la lumière de ces recherches, il semble donc que la modification du microbiote intestinal, par probiotiques ou transplantation fécale, constitue un nouvelle voie thérapeutique prometteuse pour optimiser les résultats des traitements par immunothérapie du cancer.
Mais les anticorps monoclonaux, s’ils sont principalement utilisés pour lutter contre le cancer, sont également en train de bouleverser les traitements contre certaines pathologies neurodégénératives graves, comme la sclérose en plaques ou la maladie d’Alzheimer. En juillet 2016, des chercheurs de l’Inserm ont découvert qu’en bloquant, à l’aide d’un anticorps monoclonal spécifique, l’interaction de la protéine tPA et du récepteur NMDA, qui participe à l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique, il était possible de réduire sensiblement le processus de démyélinisation qui caractérise la sclérose en plaques. Ces chercheurs sont parvenus à développer un anticorps monoclonal baptisé Glunomab, qui cible le site spécifique du récepteur NMDA sur lequel se lie le tPA.
Expérimenté chez la souris, cet anticorps est parvenu à bloquer la progression des troubles moteurs et la destruction des gaines de myéline, ce qui laisse entrevoir un réel espoir thérapeutique pour lutter contre la sclérose en plaques (Voir Inserm).
Autre avancée majeure, celle annoncée en septembre 2016 contre la maladie d’Alzheimer. Une équipe de l’Université de Zurich (Suisse) sous la direction de Roger Nitsch (Voir Nature) est en effet parvenue, en administrant pendant un an l’anticorps Aducanumab, à éliminer la quasi-totalité des plaques de protéines amyloïdes dans le cerveau de 165 patients atteints de cette maladie neurodégénérative. Le Professeur Nitsch souligne que « L’action de l’anticorps est impressionnante, et son effet dépend de la dose et de la durée de la thérapie ». Ces chercheurs ont pu mesurer les bénéfices de ce nouveau traitement sur le plan clinique, en constatant que les patients ayant bénéficié de cette thérapie voyaient leurs performances cognitives maintenues, alors que ceux appartenant au groupe placebo voyaient au contraire leurs facultés cognitives décliner… Face à ces résultats très encourageants, des essais cliniques de phase 3 sont actuellement en cours sur 2 700 patients pour confirmer les effets thérapeutiques de l’Aducanumab dans la maladie d’Alzheimer.
On le voit, les anticorps monoclonaux, combinés aux nouveaux outils d’édition génétique comme CRISPR, seront l’une des clefs de voute de la médecine de ce siècle. Ces nouveaux outils sur mesure, dont le nombre dépassera sans doute le millier au cours de la prochaine décennie, seront d’autant plus efficaces qu’ils vont de plus en plus être utilisés de manière combinée. D’ici 10 ans, grâce à l’arrivé de l’informatique exaflopique et la généralisation de l’intelligence artificielle utilisant l’apprentissage profond et les puces neuromorphiques, chaque médecin disposera d’une capacité de calcul et d’analyse qui lui permettra de choisir, en fonction de la spécificité de la pathologie de son patient et de son profil génétique personnel, l’association thérapeutique d’anticorps monoclonaux la plus efficace, parmi des dizaines de millions de combinaisons possibles…
J’ai l’intime conviction qu’à l’exception des maladies proprement génétiques, cette médecine immunitaire personnalisée de très haute précision permettra, d’ici une quinzaine d’années, de traiter la plupart des pathologies les plus dévastatrices qui nous affectent aujourd’hui, qu’il s’agisse des cancers, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies neurodégénératives, des maladies infectieuses ou encore des affections inflammatoires et rhumatismales qui touchent de plus en plus nos populations vieillissantes. Dans bien des cas, toutes ces maladies seront soit guéries soit contrôlées, ce qui signifie qu’elles deviendront chroniques et cesseront d’être mortelles.
L’une des conséquences de cette rupture scientifique et médicale absolument majeure sera que l’espérance de vie moyenne mondiale, qui dépasse déjà 70 ans (contre moins de 40 ans à la veille de la première guerre mondiale) va connaître un nouveau bond en avant et franchira sans doute les 100 ans, d’ici le milieu de ce siècle…
Notre pays qui, de Louis Pasteur à Jules Hoffmann (Prix Nobel 2011), n’a cessé d’occuper une place singulière et exceller dans ce domaine de recherche vaste et complexe de l’immunologie, doit tout mettre en œuvre pour rester au meilleur niveau mondial dans cette compétition scientifique, technologique et industrielle si importante pour notre avenir.
René TRÉGOUËT
Sénateur honoraire
Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat
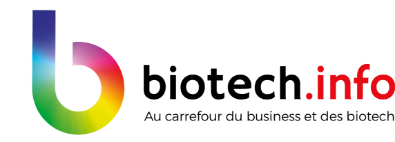
 Même si la vaccination a été pratiquée de manière empirique en Chine dès le XVIème siècle, c’est en 1776 que l’anglais Jenner mit en œuvre pour la première fois, à grande échelle sur l’homme, de manière scientifique, le principe de la vaccination : l’immunologie était née.
Même si la vaccination a été pratiquée de manière empirique en Chine dès le XVIème siècle, c’est en 1776 que l’anglais Jenner mit en œuvre pour la première fois, à grande échelle sur l’homme, de manière scientifique, le principe de la vaccination : l’immunologie était née.