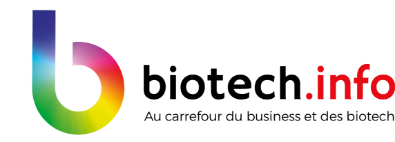Santé humaine
Édito
Maladie d'Alzheimer : il faut changer notre approche conceptuelle de la maladie
On estime que la maladie d’Alzheimer touche déjà 850.000 personnes en France, et 225.000 nouveaux malades sont diagnostiqués chaque année. Elle se traduit par une dégénérescence lente mais inexorable des neurones, qui débute au niveau de l’hippocampe puis s’étend à l’ensemble du cerveau. Elle se caractérise par des troubles de la mémoire à court terme, des fonctions d’exécution et de l’orientation dans le temps et l’espace. Le malade perd progressivement ses facultés cognitives et son autonomie.
En dépit des moyens considérables engagés de par le monde depuis plus de 20 ans pour essayer de comprendre les causes de cette maladie très complexe et de la traiter efficacement, aucune percée thérapeutique majeure n’a été réalisée à ce jour et la médecine ne peut, au mieux, que ralentir, dans certains cas, les effets dévastateurs de cette maladie.
Face à cette situation, et alors que cette terrible maladie touche déjà plus de 10 millions de personnes dans le monde et devrait en affecter 45 millions en 2050, la communauté scientifique est en train de remettre profondément en question la théorie dominante qui veut que la présence croissante de plaques de la protéine amyloïde dans le cerveau soit la principale cause déclenchant cette maladie si redoutée.
En fait, cette théorie avait été remise en cause dès 2011 par une étude suédoise dirigée par Davide Tampellini (Université de Lund) qui parvenait à la conclusion que c’était l’incapacité des neurones à poursuivre la synthèse des peptides ?-amyloïdes qui était à l’origine de la maladie d’Alzheimer (Voir Lund University). Ces travaux avaient en effet montré que le niveau de sécrétion des peptides ?-amyloïde se réduisait avec le temps dans des cultures de neurones de souris transgéniques Alzheimer mais pas dans des cultures de neurones issus de souris normales. Contrairement à la théorie dominante qui considère que les plaques extracellulaires de peptides ?-amyloïdes sont la principale cause d’Alzheimer, cette étude montrait que c’est la réduction des signaux de sécrétion des peptides ?-amyloïde qui pourrait être à l’origine de la maladie d’Alzheimer.
A la suite de ces travaux, le Professeur Tampellini a proposé une nouvelle explication de la maladie d’Alzheimer, avec sa théorie de l’accumulation intracellulaire précoce. Selon cette théorie, quand des peptides ?-amyloïdes se concentrent dans le neurone, ils s’accumulent également dans les synapses de ces neurones. Lorsque ces synapses deviennent incapables de stocker ces peptides, la membrane cellulaire est détruite, ce qui entraîne un relâchement massif de ces peptides ?-amyloïdes dans l’espace extra-cellulaire. Il s’en suit une formation des plaques visibles de la maladie d’Alzheimer. Ces plaques ne seraient donc pas la cause mais la conséquence de cette pathologie.
L’année dernière, des travaux français menés par l’équipe de David Blum et Luc Buée (Université de Lille/Inserm) sont venus conforter une autre hypothèse, également très intéressante : la maladie d’Alzheimer serait une forme de « diabète » du cerveau et pourrait être liée à une perte de sensibilité des neurones à l’insuline, l’hormone qui régule le taux de sucre dans le sang (Voir JEM). Selon cette étude, se serait l’absence de la protéine tau qui provoquerait une résistance neuronale à l’insuline, favorisant ainsi les lésions cérébrales. Comme le souligne David Blum, « Nos travaux suggèrent que la perte de fonction de la protéine tau peut induire une résistance à l’insuline dans le cerveau, telle qu’elle est observée dans les cerveaux des malades d’Alzheimer ».
Si cette piste du « diabète cérébral » était confirmée, elle ouvrirait également des perspectives thérapeutiques tout à fait nouvelles contre la maladie d’Alzheimer. Or, il se trouve qu’il y a seulement quelques jours, une équipe britannique de l’Université de Lancaster a montré qu’un médicament initialement mis au point pour le traitement du diabète semblait avoir sur la souris une efficacité thérapeutique remarquable pour traiter la maladie d’Alzheimer. Ce traitement provoque à la fois une diminution des plaques amyloïdes dans le cerveau, une réduction de l’inflammation chronique et du stress oxydatif et enfin un ralentissement de la perte des cellules nerveuses (Voir Science Direct).
Il y a quelques semaines, une étude franco-canadienne est venue à son tour bousculer le consensus scientifique actuel, celui qui considère la maladie d’Alzheimer comme une maladie neurodégénérative, se traduisant par une perte progressive et irréversible de neurones et de synapses. Réalisés à partir des données provenant de l’analyse des cerveaux de 170 sujets décédés qui étaient atteints d’Alzheimer à des stades différents, ces travaux montrent au contraire que la maladie s’accompagne d’une faible diminution de marqueurs neuronaux et synaptiques. Les scientifiques ont été très surpris par leurs observations car ils étaient convaincus de trouver un marqueur de la maladie qui aurait indiqué sa progression au niveau des synapses.
Pourtant, bien qu’ils aient étudié huit des protéines marquant ces synapses, ces scientifiques ont dû se rendre à l’évidence : il ne semble y avoir aucune corrélation entre la diminution du nombre de synapses – les connexions entre les neurones – et le niveau de démence observée.
« En étudiant le devenir de huit marqueurs neuronaux ou synaptiques situés dans le cortex préfrontal de nos sujets, nous n’avons constaté, à notre grande surprise, que de très faibles pertes de neurones et de synapses. Notre étude suggère donc que, contrairement à ce qu’on pensait, la perte neuronale et synaptique est relativement limitée dans la maladie d’Alzheimer. C’est un changement radical de perspective », explique le Professeur Salah El Mestikawy, de l’Université McGill (Voir Nature).
Partant de ce premier constat, l’équipe scientifique a ensuite cherché à établir une corrélation entre l’ensemble de ces baisses synaptiques limitées et le niveau de démence de tous les participants étudiés. Les résultats ont confirmé que les baisses des biomarqueurs synaptiques ont peu d’impact sur les capacités cognitives des sujets. L’étude suggère ainsi que la maladie d’Alzheimer serait plutôt liée à un dysfonctionnement des synapses, donc des connexions entre les neurones, et non à leur disparition du cortex des patients. Selon ces conclusions, l’identification de ce dysfonctionnement pourrait aboutir à des traitements efficaces de cette maladie car à ce jour, aucun d’entre eux ne peut guérir ni stopper son évolution. « Jusqu’à aujourd’hui, les interventions thérapeutiques visaient à ralentir la destruction des synapses, mais cette voie n’est peut-être pas la bonne », précise Salah El Mestikawy.
Ces chercheurs veulent à présent étudier les synapses dans plusieurs autres régions du cerveau que le cortex préfrontal, comme l’hippocampe, une région-clé dans les processus de mémorisation. Ils espèrent qu’à terme, les progrès réalisés dans la tomographie par émission de positons (TEP), qui consiste à injecter des radiotraceurs qui vont se lier spécifiquement aux lésions cérébrales caractéristiques de la maladie, permettront de mesurer les synapses directement dans le cerveau des patients vivants, et ce pendant des années, pour constater d’éventuelles modifications correspondant à l’apparition de la maladie.
Il y a quelques semaines, une autre étude est venue également remettre en cause la théorie dominante des plaques amyloïdes comme cause principale de la maladie d’Alzheimer. Prolongeant les travaux de Johan Auwerx à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l’équipe de Diego Mastroeni, de l’Université d’État de l’Arizona, a examiné les effets de la maladie d’Alzheimer sur le fonctionnement des mitochondries, des structures à l’intérieur des cellules qui produisent l’énergie (Voir Alzheimer’s & Dementia.)
Ces scientifiques ont montré qu’une forme très toxique de la protéine bêta-amyloïde, l’oligomère a-bêta (OAbêta) peut venir altérer le fonctionnement normal des mitochondries, ce qui va enclencher une cascade de réactions moléculaires et biologiques qui se manifestent plusieurs décennies avant l’apparition des premiers symptômes cliniques d’Alzheimer. Mais cette étude a également montré que certaines substances peuvent protéger les cellules neuronales humaines du stress oxydatif qui détériore leurs mitochondries. A cet égard, deux de ces composés semblent très prometteurs selon ces chercheurs : la vitamine nicotinamide riboside (une forme de vitamine B3) et un antioxydant, la coenzyme Q10 (CoQ10).
Ces recherches récentes viennent donc porter un nouveau coup à la théorie des plaques amyloïdes, qui pourrait bien être, soit erronée, soit incomplète et semble de plus en plus impuissante à expliquer, à elle seule, l’apparition de la maladie d’Alzheimer. Comment en effet expliquer que certains patients âgés qui présentent une forte accumulation de ces plaques dans leur cerveau n’aient pas de déficit cognitif mesurable, alors que d’autres qui présentent au contraire peu ou pas d’accumulation d’amyloïdes souffrent de formes sévères de cette maladie ?
Il est par ailleurs inexplicable que plusieurs médicaments expérimentaux, pourtant efficaces pour détruire ces plaques amyloïdes, n’aient pas permis d’obtenir de bénéfices thérapeutiques notables au cours des essais cliniques. Dans ce contexte, l’hypothèse d’une longue cascade de réactions moléculaires et biologiques menant à la maladie, et déclenchée par une dysfonction des mitochondries, semble très intéressante, d’autant plus qu’on sait que cette fonction mitochondriale décline avec le vieillissement et s’altère encore plus vite sous l’effet de la protéine bêta-amyloïde.
Comme le souligne Johan Auwerx, en pointe sur ces recherches à l’EPFL, « Nous avons montré que restaurer la santé mitochondriale réduit la formation de plaques – mais, surtout, cela améliore la fonction cérébrale, ce qui est l’objectif ultime pour tous les patients et les chercheurs dans l’Alzheimer. »
Il faut également rappeler qu’une autre théorie, qui n’est d’ailleurs pas incompatible avec celle des mitochondries, considère que le système immunitaire peut jouer un rôle clé dans le développement de la maladie d’Alzheimer, Dans cette perspective, la maladie d’Alzheimer serait en fait déclenchée par une réponse immunitaire en réponse à des bactéries ou d’autres agents pathogènes. Cette théorie s’est trouvée confortée en 2016 par deux études, l’une américaine, de l’Ecole de Médecine d’Harvard et l’autre australienne, de l’Université d’Adelaide.
Selon Rudy Tanzi et Robert Moir, chercheurs au sein de la prestigieuse université médicale de Harvard, la maladie d’Alzheimer pourrait en effet être déclenchée par une réaction immunitaire intempestive chez certains patients dont l’organisme est submergé par certains agents pathogènes, qu’il s’agisse de bactéries, comme celles qui cause la maladie de Lyme, de virus ou encore de champignons, comme la chlamydia (Voir Frontiers in Neuroscience).
Pour Rudy Tanzi, les facteurs liés au mode de vie pourraient jouer un rôle essentiel dans la prévention de cette maladie, et notamment l’alimentation, l’exercice physique et la qualité du sommeil. Ce chercheur reconnu souligne également que certains vaccins, ou encore certains médicaments réduisant l’inflammation, comme l’aspirine, semblent avoir à long terme des effets protecteurs en diminuant les risques de maladie d’Alzheimer et en retardant l’apparition de cette pathologie.
Cette piste immunitaire a été confirmée, toujours en 2016, par des travaux australiens menés par Robert Richards de l’Université d’Adelaide. Cette équipe a montré que le déclin neurologique commun à ces maladies est causé par une réaction inflammatoire persistante du système immunitaire qui finit par provoquer la mort de cellules cérébrales.
Ces chercheurs ont montré de manière convaincante que, derrière l’apparence d’une spécificité des principales maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer, de Parkinson et de Huntington) on retrouve un mécanisme commun qui conduit à la perte de cellules nerveuses. « Nous avons commencé à soupçonner le système immunitaire inné d’être responsable de ces pathologies quand nous avons découvert que des agents du système immunitaire étaient activés dans un modèle de laboratoire de la maladie de Huntington », précise à cet égard le Professeur Richards.
Selon ce chercheur, plusieurs types d’événement, comme des mutations génétiques, des infections, des toxines ou des blessures physiques, pourraient à la longue déstabiliser le système immunitaire et conduire à différentes formes de neurodégénescence, dont Alzheimer, entraînant in fine la mort des cellules cérébrales.
Cette piste immunitaire s’est d’ailleurs trouvée confortée fin 2016, par des travaux réalisés par des chercheurs suédois de l’Institut Karolinska de Stockholm qui ont montré qu’un vaccin expérimental – l’AADvac1 – ciblant la protéine tau (Tubule-Associated Unit) et testé dans le cadre d’essais cliniques de phase 1 sur 30 patients âgés de 50 à 85 ans a permis sur 29 d’entre-deux d’obtenir une réponse immunitaire spécifique. Si les essais cliniques de phase 2 et 3, actuellement en cours, confirment ces bons résultats, ce vaccin thérapeutique (à ne pas confondre avec les vaccins préventifs) pourrait être disponible vers 2022.
Évoquons enfin une étude publiée il y a quelques jours et conduite par Emily Rogalski, professeure en neurologie cognitive à l’Université Northwestern à Chicago. Après avoir étudié le cerveau de 10 superseniors décédés, ces travaux ont montré qu’ils possédaient une plus grande quantité d’un certain type de cellules cérébrales, connues sous le nom de neurones Von Economo, une catégorie de neurones que l’on trouve notamment dans le cortex cingularis anterior et qui jouent un rôle important dans la communication entre les aires cérébrales (Voir Science Alert).
Cette étude révèle également, et ce point est crucial, que les superseniors, tous âgés de plus de 90 ans, bien que possédant un niveau relativement élevé de protéine bêta-amyloïde, présentent des capacités cognitives meilleures que celles de quinquagénaires exempts de la maladie d’Alzheimer… Ce paradoxe semble donc bien confirmer que certaines personnes sont protégées tout au long de leur longue vie des effets neurotoxique de cette protéine.
Autres enseignements de ces travaux, les superseniors consacrent au moins deux heures par jour à une activité intellectuelle et pratiquent, en moyenne, 30 minutes d’activité physique intense par jour. Ils accordent également beaucoup d’importance aux relations et aux contacts sociaux, et dorment huit heures par nuit en moyenne. Cette étude montre également qu’une consommation modérée d’alcool et de café semble plutôt bénéfique pour le cerveau, ainsi qu’un léger surpoids.
A la lumière de l’ensemble de ces avancées et découvertes cliniques et fondamentales, on voit à quel point la maladie d’Alzheimer est une pathologie complexe et déroutante qui revêt de multiples dimensions, d’ordres génétiques, immunitaires, métaboliques et environnementales. Compte tenu de cette nouvelle réalité scientifique, il semble aujourd’hui admis qu’il faut complètement reconstruire le cadre théorique et conceptuel d’approche de cette maladie, pour y intégrer l’ensemble de ces nouvelles connaissances et déboucher enfin sur des ruptures thérapeutiques qui permettent de prendre en charge les malades, non seulement lorsque la maladie en est encore à un stade précoce, mais également dans les formes plus avancées et plus sévères.
Sachant que le nombre de malades pourrait doubler en France au cours des 20 prochaines années, souhaitons que notre pays prenne conscience de cet enjeu scientifique et social majeur et y consacre les moyens humains et financiers qui permettront enfin de ne plus être impuissants et démunis face à cette terrible maladie.
René TRÉGOUËT
Sénateur honoraire
Fondateur du Groupe de Prospective du Sénat